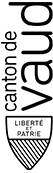Les logements protégés: une opportunité de vivre chez soi plus longtemps
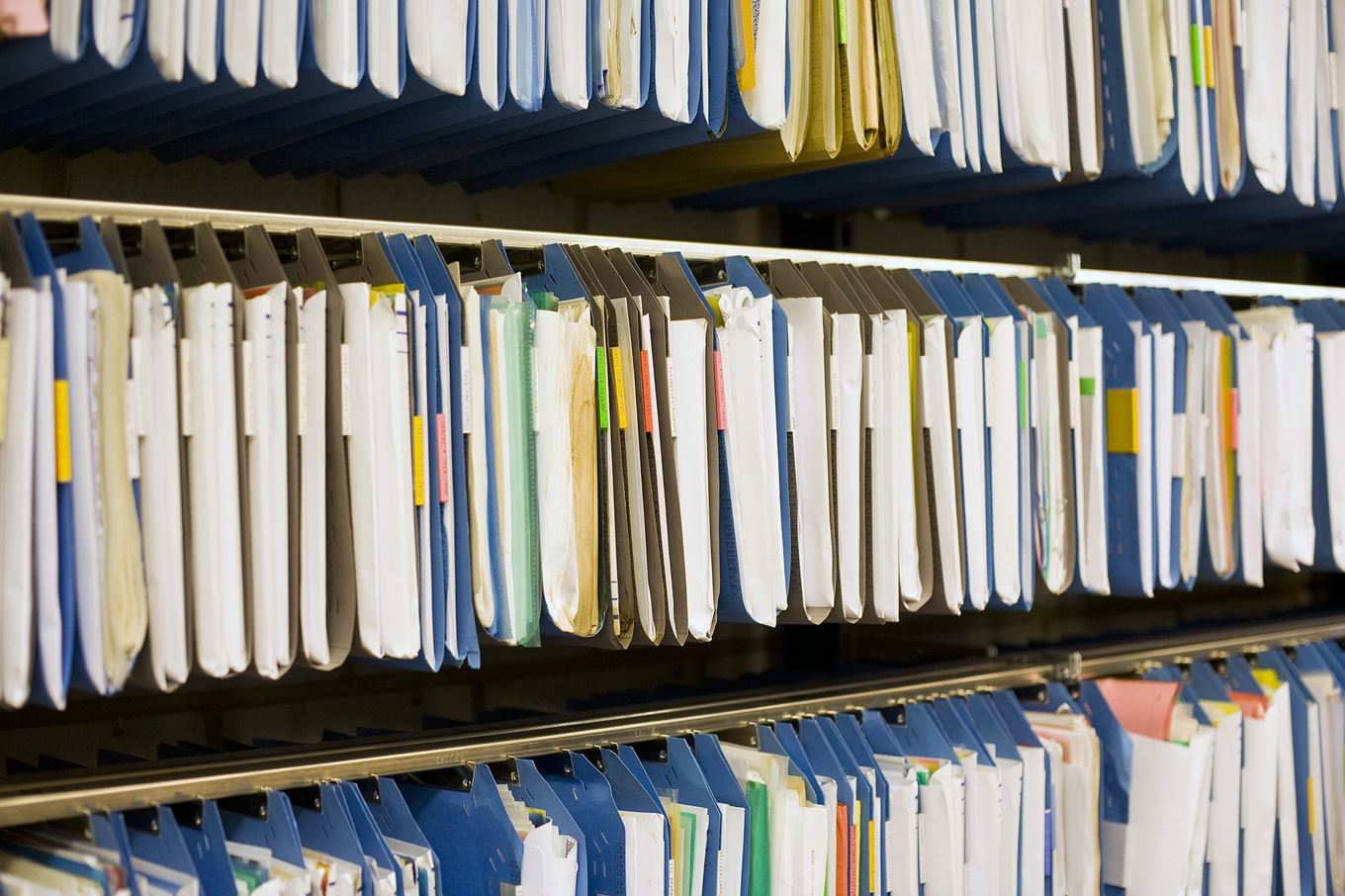
De nos jours, une majorité de personnes vieillissantes souhaite vivre chez elle aus- si longtemps que possible.
Toutefois, avec l’avancée dans l’âge et les fragilisations qui en résultent, un accompagnement conséquent et adapté devient souvent indispensable.
Le concept de logement protégé constitue alors une alternative intéressante.
Par cet article, le Service des assurances sociales et de l’hébergement souhaite informer les communes sur les logements protégés et sur les possibilités d’obtenir un soutien pour le développement de tels projets, notamment une aide à la pierre permettant d’en alléger les coûts.
Qu’est-ce qu’un logement protégé ?
Il faut tout d’abord distinguer les logements adaptés des logements protégés.
Les logements adaptés sont caractérisés par une architecture facilitant l’accès aux personnes à mobilité réduite. Concrètement, ils sont par exemple aménagés de manière à pouvoir s’y déplacer en fauteuil roulant, accéder facilement aux sanitaires ou regarder par la fenêtre, même depuis son lit.
Les logements protégés, en plus de répondre à ces mêmes normes architecturales, bénéficient d’un encadrement sécuritaire, comme un système d’alarme et une conciergerie « sociale ». On y trouve également un espace communautaire, permettant les échanges autour d’un café ou d’un repas et la participation à diverses animations.
De manière générale, les appartements adaptés ou protégés comprennent deux ou trois pièces. Afin de favoriser l’intégration sociale et l’autonomie des habitants, ils sont préférablement localisés dans des zones urbaines ou villageoises, à proximité des commerces, des transports publics et autres facilités.
Ces logements peuvent également se situer dans le périmètre de structures mixtes, permettant une synergie avec un EMS, un centre médico-social (CMS) ou un hôpital.
Un soutien de l’Etat
La construction de logements adaptés ou protégés relève actuellement d’initiatives privées. Dès lors, elle n’est pas soumise à une autorisation d’exploiter au sens de la Loi sur la santé publique (LSP), ni à la planification sanitaire cantonale édictée en application de l’article 39 de la LAMal.
Néanmoins, au vu de l’importance du développement de ce type de structures, un certain nombre de mesures ont été mises en place par les autorités cantonales.
En premier lieu, par le biais de conseils techniques et architecturaux, le Service de la santé publique (SSP) peut fournir un appui dans la conception et le démarrage de projets. En deuxième lieu, l’Etat peut apporter aux investisseurs une aide à la pierre sous la forme d’un prêt sans intérêt remboursable, à concurrence de 20% de l’investissement. Et en troisième lieu, le Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH) peut octroyer une aide financière individuelle aux locataires bénéficiant des régimes sociaux pour les prestations spécifiques aux logements protégés, telles que l’encadrement sécuritaire, la mise à disposition de locaux communautaires ou l’accom- pagnement social et d’animation.
L’offre actuelle et future
D’après un inventaire réalisé par l’Association Avril sous le mandat du Département de santé et de l’action sociale (DSAS), il existe à ce jour 32 immeubles totalisant plus de 1000 logements adaptés ou protégés dans le canton de Vaud. D’ailleurs, un catalogue interactif sera disponible pour le public sur le site du SASH dès le premier trimestre 2010.
En ce qui concerne les développements, 39 projets de construction ont été répertoriés par le DSAS. Leurs niveaux d’avancée sont très variés, allant de l’étude de faisabilité à la phase finale du chantier. Ceci représente un potentiel d’environ 770 appartements, dont plus de 200 seront achevés en 2010 (8 projets).
Troisième pilier de la politique médico-sociale du Canton de Vaud, les logements protégés sont donc aujourd’hui en pleine extension.
Complémentaires aux deux autres piliers que sont les EMS et les services de soins à domiciles, ils représentent une opportunité pour les personnes âgées de vivre chez elles plus longtemps, dans un environnement de proximité par rapport à un ancien lieu de vie, tout en bénéficiant d'un encadreement sécuritaire et social adéquat. De ce point de vue, les communes sont appelées à jouer un rôle facilitateur pour le développement de cette offre.
Rôle et responsabilité des communes
Concrètement, afin de soutenir voire d’initier des projets de construction de logements protégés, les possibilités pour les communes sont par exemple de mettre à disposition des promoteurs des terrains communaux en droit de superficie, ou en recherchant d’autres formes de partenariat public-privé.
Il est important que les communes intègrent les problématiques liées à la politique de la vieillesse en permettant aux personnes concernées de bénéficier d’une alternative lorsque leur logement devient inadapté pour des raisons architecturales ou d’encadrement social ou médical insuffisant.
Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH)
Informations
Service des assurances sociales et de l’hébergement
Bâtiment administratif de la Pontaise - 1014 Lausanne
Tél.: 021 316 51 51 - info.sash@vd.ch