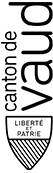Le Grand Conseil et les communes : un ajustement continuel
Tous les cinq ans, à l’approche des élections cantonales, la thématique des relations entre le Canton et les communes s’invite immanquablement dans les débats du Grand Conseil avec une intensité renouvelée. Ce constat se vérifie d’autant plus que la question de l’autonomie communale est devenue une problématique transversale, s’invitant aux détours de nombreux dossiers débattus par le Législatif cantonal.

Deux exemples marquants et récents de la sensibilité que recouvre ce thème peuvent être cités :
1. Il est pratiquement inévitable de voir la problématique de la fiscalité et des charges pesant sur les communes s’inviter lors des débats de décembre sur le budget de l’Etat de Vaud. Ces questions sont désormais récurrentes et prennent le dessus depuis quelques années sur toutes les autres questions, au moins en termes de débats consacrés ;
2. Dans un récent arrêt du Tribunal cantonal au sujet de la répartition de la facture sociale, la Cour de droit administratif et public est allée jusqu’à écrire que « le système légal actuel n'est pas adéquat et entraîne des résultats qui ne sont conformes ni à l'autonomie communale ni au principe de proportionnalité ». En d’autres mots, les juges en appellent au pouvoir législatif afin de changer la loi, précisant que c’est là une « question qui est politique ».
Cette jurisprudence du Tribunal cantonal et les débats budgétaires viennent souligner combien la question de l’équilibre et de la répartition des charges entre Canton et communes nécessite d’être reprise. Pour autant qu’elle aboutisse, une telle réforme devra parvenir à convaincre une majorité du Grand Conseil, qui, il est important de le rappeler, comprend parmi ses membres un tiers environ de conseillers-ères municipaux-ales et de syndics-ques (voir l’article «Le "lobby des communes : mythe ou réalité" au Grand Conseil»).
Sans tomber dans le simplisme, une grande partie des débats du Grand Conseil à propos de la répartition des charges entre le Canton et les communes pourrait néanmoins être résumée par le principe « qui commande paie », que l’on retrouve de plus en plus souvent dans le discours des députées et députés, spécialement lorsqu’ils sont également conseillers municipaux ou syndics.
A l’occasion d’un débat au Grand Conseil le 16 septembre 2014, la popularité de cet adage a été attribuée au Conseiller d’Etat Claude Ruey : « Voilà de nombreuses années que l’Etat de Vaud avance le principe de « qui paye commande et qui commande paye ». Nous connaissons cet adage depuis le conseiller d’Etat Claude Ruey – c’est dire si cela dure depuis longtemps – qui nous le rappelait souvent. Mais l’Etat de Vaud n’applique ce principe que lorsque cela l’arrange. Cet adage subit régulièrement des entorses au détriment des communes. »
A vrai dire, cette référence ne date pas d’aujourd’hui ni des temps modernes, bien au contraire, puisque M. le député Aymon de Gingins, de La Sarraz, mentionnait déjà ce principe dans le cadre qui nous intéresse lors de la séance du Grand Conseil du 23 février 1886 :
« Cet article met à la charge des communes tous les soins à donner aux malades épidémiques et contagieux. On a tendance à grever les communes de frais, et de les contraindre à payer. Il fut un temps où l’on disait «qui paie commande», aujourd’hui c’est à peu près le contraire. Le fait de payer ne donne aucun droit de commander. Le principe «qui commande paie» doit seul être appliqué. L’Etat seul commande, lui seul doit payer les frais. »
Plus récemment, si l’on s’en tient à la législature en cours, on peut observer que la prégnance de ce « petit proverbe si vaudois » marque de son sceau presque l’entier des relations Canton - communes. Qu’on en juge parmi plusieurs interventions parlementaires emblématiques, trouvées dans le Bulletin du Grand Conseil, dans trois domaines fréquemment débattus.
- C’est le cas des constructions scolaires où quatre objets ont été déposés entre 2016 et 2021 en lien avec cet adage.
- La question du financement des fusions de communes est également un sujet disputé avec trois objets traités au Parlement sur cette même période.
- Mais c’est surtout à travers la thématique omniprésente des péréquations directe et indirecte que les députés ont eu tout loisir d’épiloguer sur la question de la répartition des charges entre collectivités. La péréquation intercommunale et la facture sociale ont engendré pas moins de treize motions, postulats, résolutions et autres questions.
Liste des objets parlementaires concernés
On le voit, la liste est longue et les député-e-s sont productifs dans ces domaines. Parmi les autres sujets qui touchent en première ligne les communes, et qui font l’objet de discussions souvent animées au Grand Conseil, on peut citer, également:
- L’organisation policière
- La loi sur les communes
- La loi sur l’exercice des droits politiques
- La loi cantonale sur l’aménagement du territoire
- La loi sur l’accueil de jour
- La loi sur les écoles de musique
- La loi sur le contrôle des habitants et les naturalisations
Ou encore la sécurité informatique, qui a passablement défrayé la chronique ces derniers temps.
Sur la plupart de ces thèmes, on relèvera une tendance qui s’est accentuée - pour ne pas dire imposée - ces dernières années, contestée d’un point de vue institutionnel par plusieurs député-e-s : il n’est pas rare que le Conseil d’Etat négocie des compromis directement avec des associations de communes, dans le cadre de ce qu’il est habituel d’appeler des « Plateformes Canton-communes ».
Souvent, les accords trouvés sont cependant questionnés par plusieurs acteurs : les député-e-s se voient mis devant le fait accompli, et la pression qui pèsent sur eux afin de ne pas déficeler les accords trouvés est grande.
Du côté des communes, au vu de leur grande diversité, certaines ne se reconnaissent pas dans les compromis trouvés. Il est donc à espérer qu’à l’avenir, les négociations entre le gouvernement et les communes puissent intégrer une nécessaire représentation du Grand Conseil, en amont, par exemple au travers de commissions thématiques ou instituées, telles que la Commission des droits politiques et des institutions ou la Commission des finances. Il y a là en tout cas une marge pour améliorer les processus pratiqués jusqu’ici.
Sur un tout autre plan, moins connu, qui tient au fonctionnement interne du Grand Conseil, un autre exemple peut servir d’indicateur de l’acuité du débat. Le Bureau du Grand Conseil, composé de la présidence, des deux vice-présidences et de quatre membres, soit en tout sept député-e-s, est en charge de nommer toutes les deux semaines les commissions qui examineront les objets adoptés par le Conseil d’Etat et discutés par la suite en plénum.
Selon la sensibilité qui prévaut au sein du Bureau - cet organe fondamental dans la gouvernance du Grand Conseil (il n’est pas rare d’entendre dire que le Bureau du Grand Conseil est le « gouvernement du parlement ») - en d’autres mots, selon que ses membres sont actifs ou non au sein de municipalités (et dans lesquelles), la décision d’attribuer certains objets à des commissions instituées en début de législature (par exemple la Commission des finances) ou à des commissions ad hoc - ponctuellement mises sur pied pour examiner un objet particulier - pourra varier.
Les partisans d’une plus grande représentation des communes dans l’appréciation de certains thèmes à discuter ensuite au Grand Conseil valideront ainsi plus facilement l’attribution à des commissions ad hoc, lesquelles pourront plus aisément compter dans leurs rangs des représentant-e-s des communes. C’est là un autre exemple de la sensibilité de la problématique au sein du Grand Conseil.
Enfin, au moment où les élections cantonales vont délivrer leurs résultats, il est intéressant de se rappeler que les législatures communale et cantonale décalées d’une année font que les élections communales sont de nature à influencer, qu’on le veuille ou non, les élections cantonales. Les résultats des premières peuvent renforcer et légitimer certain-e-s député-e-s à se représenter, voire contraindre d’autres à changer de stratégie ou augmenter leur visibilité. En ce sens, les élections communales influencent celles cantonales et participent d’une imbrication appelée à perdurer.
Celle-ci remonte à loin, comme le proclamait Robespierre à l'Assemblée nationale sur le nouveau gouvernement représentatif, le 10 mai 1793, dans un discours avec des accents de déjà-vu : « (…) laissez aux communes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs propres affaires, en tout ce qui ne tient point essentiellement à l’administration générale de la République ».
Il faut espérer que la législature à venir permettra aux différentes actrices et acteurs de ces dossiers de trouver les justes compromis et des solutions adéquates, éventuellement différenciées, mais toujours respectueuses des intérêts des communes et du Canton.
Igor Santucci,
Secrétaire général du Grand Conseil