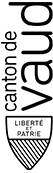Le retour de la pauvreté et les moyens d’actions de l’Etat
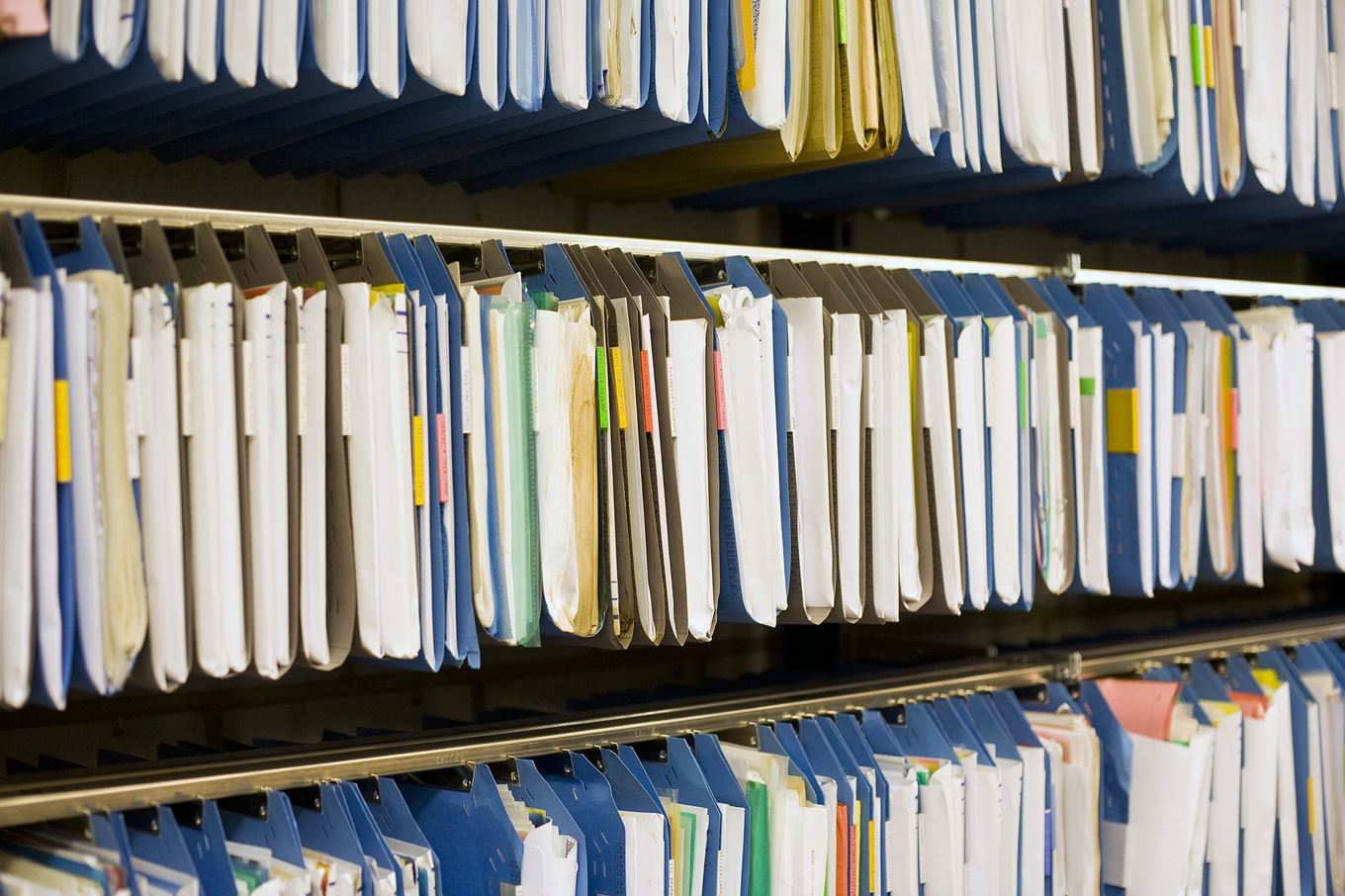
Le nombre de travailleurs pauvres qui bien qu’exerçant une activité lucrative touchent un revenu qui se situe en-dessous des minima sociaux établis, ne cesse d’augmenter. Ces dernières années, le 25% des ménages en bas de l’échelle ont vu leur revenu disponible fondre de 10% à 15%.
Sur le plan suisse, le phénomène des «working poors» concerne aujourd’hui environ 200’000 salariés et 500’000 personnes en tenant compte des membres de leur ménage.
18’000 dans le canton
Dans le canton de Vaud, selon une étude du Service de recherche et d’information statistiques, 18’000 travailleurs en font partie, c’est-à-dire plus de 6% de la population active.
C’est cette évolution qui explique qu’aujourd’hui environ un cinquième des dossiers traités par les Centres sociaux régionaux concerne des ménages dont un ou plusieurs membres ont un travail.
Bref, dix ans de crise et de chômage et dix ans de réduction des revenus disponibles dans les métiers mal payés ont fait en sorte que la lutte contre la pauvreté est redevenue un enjeu majeur de la politique sociale.
Une loi cadre
En janvier 2006 est entrée en vigueur la Loi sur l’action sociale vaudoise (LASV) qui met l’accent sur les mesures devant permettre aux bénéficiaires de l’aide sociale de regagner leur autonomie.
Pour ce faire, le Département de l’économie (DEC) et le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) se partagent le travail et les responsabilités.
Alors que le département dirigé par ma collègue Jacqueline Maurer prend en charge les personnes considérées comme étant aptes au placement et donc inscrites auprès d’un office régional de placement (ORP), mon département et les Centres sociaux régionaux (CSR) s’occupent de celles et ceux qui, pour différentes raisons, ne peuvent être suivis par l’ORP.
Pour ces bénéficiaires, il s’agit aujourd’hui de multiplier les mesures formatives et d’acquisition de connaissances élémentaires (écriture, lecture, utilisation de l’informatique) mais également des mesures qui permettent une activité proche du monde du travail.
Des projets innovants
Outre le projet visant l’insertion des jeunes mis en place par trois départements et dont les résultats sont encourageant, le DSAS souhaite développer, d’ici la fin de l’année, d’entente avec ses différents partenaires, d’autres programmes d’insertion dont la finalité est constituée par le recouvrement de l’aptitude au placement, l’acquisition d’un titre de formation reconnu et l’accès au marché du travail.
Une année décisive
2006 aura été une année décisive pour l’avenir des politiques sociales de notre canton. Le bilan global que l’on peut tirer de l’entrée en vigueur du RI est certes encourageant, mais il met également en lumière les difficultés que connaît un nombre important de Vaudoises et de Vaudois. Les aspects inquiétants ont trait à la montée en flèche de la pauvreté.
La reprise de la croissance et la création d’emplois auront un impact durable sur le nombre de personnes dépendantes de l’aide sociale, mais cela ne suffit manifestement pas.
Les éléments positifs par rapport à l’aide sociale viennent quant à eux du développement d’une véritable politique d’insertion et du bon fonctionnement de l’octroi de l’aide – entretiens fréquents avec les bénéficiaires du RI, renforcement des mesures visant à réduire les prestations indues, formation des collaboratrices et collaborateurs des CSR. Je suis confiant de pouvoir compter comme pendant l’année passée sur le soutien des communes et de leurs représentants dans les différentes structures de coordination avec le Canton et je vous remercie sincèrement pour la bonne entente qui caractérise nos relations.
Pierre-Yves Maillard,
Conseiller d'Etat, chef du Département de la santé de de l'action sociale