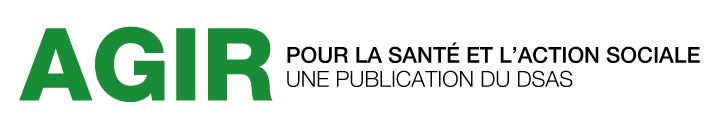L’engorgement des hôpitaux, c’est quoi exactement ?
C’est la canicule, les personnes âgées sont déshydratées, ou l’hiver et les virus circulent : l’engorgement des hôpitaux menace. Marco Martinuz, directeur adjoint à la Direction Hôpitaux, explique le fonctionnement du dispositif cantonal créé par le Département de la santé et de l’action sociale pour éviter que des patients restent sans solution.
Chaque année, principalement pendant les périodes de fêtes de fin d’année, des patients affluent aux urgences et les temps d’attente s’allongent. Dans la suite logique, les services des établissements hospitaliers sont surchargés. « Les hôpitaux disposent d’un nombre de places fixe, qui implique un certain nombre de professionnels. Mais cela correspond à un fonctionnement ordinaire, indique Marco Martinuz, directeur adjoint à la Direction Hôpitaux du DSAS. La situation d’engorgement apparaît lorsque cet afflux n’est pas rééquilibré par un nombre équivalent de départs de patients des soins continus. »
Ce phénomène, qui touche la Suisse mais aussi toute l’Europe, est géré par le DSAS via un dispositif cantonal de désengorgement des hôpitaux et une évaluation en continu du flux de patients par la Direction Hôpitaux de la Direction générale de la santé. Actuellement, le dispositif se base sur la surveillance de ce flux de patients pour les urgences et les services de soins continus, de médecine et de chirurgie du CHUV et des hôpitaux de la FHV.
Patients âgés et polymorbides
Ces situations de surcharge sont principalement liées aux épidémies hivernales (grippe, infections des voies respiratoires, etc.) mais aussi, parfois, aux périodes de canicules. « Les patientes et patients qui ont plusieurs maladies sont particulièrement fragiles et sont fortement affaiblis par des virus ou par la chaleur. Leur état de santé implique aussi des durées plus longues d’hospitalisations » explique Marco Martinuz. En outre, une partie d’entre eux, une fois remis sur pied, doivent être orientés en EMS. « Il y a dix ans, majoritairement on quittait son domicile pour entrer en EMS. Aujourd’hui, plus de la moitié de ces entrées se font à la suite d’une hospitalisation. »
Mais depuis la pandémie de COVID, ces institutions, à l’instar de l’ensemble du système de soins, font face à une pénurie de personnel. Ainsi, le manque de places dans les EMS se répercute sur les hôpitaux où des patients sont en attente de placement. « Depuis 2022, on constate une forte interdépendance entre les différents prestataires du dispositif socio-sanitaire : des fermetures de cabinets médicaux durant les vacances scolaires ont une incidence directe sur l’augmentation d’activité des services d’urgences hospitalières, de même que les capacités des centres ambulatoires à prendre en charge des urgences ou la possibilité de maintenir les patients à domicile grâce aux CMS ont aussi un impact sur l’engorgement des hôpitaux. »
Un soin particulier doit donc être apporté à la coordination entre tous les acteurs du domaine. Celle-ci est chapeautée par le DSAS. Des représentants de la DGS, gestionnaires de flux des patients des hôpitaux et d’autres acteurs du système de santé se rencontrent régulièrement pour évaluer les situations de tensions ou de blocage, selon des paliers – qui s’échelonnent de 1 à 4, et indiqués sur le site du Canton. A chaque niveau correspond une organisation spécifique en matière de communication et de transfert des patients entre les établissements hospitaliers du canton. « À partir du niveau 3, la situation devient préoccupante », indique Marco Martinuz. Le passage au niveau 4 relève de la compétence de la Cheffe de département.
Lorsque le monitorage indique un début de tension, la Direction générale de la santé déclenche le passage au niveau supérieur « L’un des enjeux principaux lié à l’engorgement est le fait que le CHUV est l’hôpital de dernier recours. Il doit être en mesure d’absorber en tout temps les cas les plus complexes qui lui sont adressés par les autres établissements, et donc disposer en tout temps de disponibilités pour les accueillir. Les autres hôpitaux doivent reprendre les patients dans leurs murs dès que la situation s’est stabilisée », précise Marco Martinuz. Enfin, au niveau 4, les hôpitaux peuvent être amenés à reporter des opérations non-vitales et non urgentes, ou encore renforcer leurs unités de quelques lits, voire accueillir temporairement des patients dans des unités d’autres spécialités où il reste des lits disponibles.
L’objectif de ce dispositif est que les hôpitaux et les réseaux de soins puissent organiser les transferts des patients de la manière la plus fluide possible. « Le personnel infirmier des bureaux régionaux d’information et d’orientation (BRIO), qui accompagnent les personnes au moment de leur entrée en EMS, par exemple, est essentiel, souligne Marco Martinuz. La crise du COVID nous a beaucoup renforcés dans la gestion de l’engorgement. Pour que cela fonctionne bien, il faut que les institutions se connaissent et se fassent confiance, ce qui est actuellement le cas. »